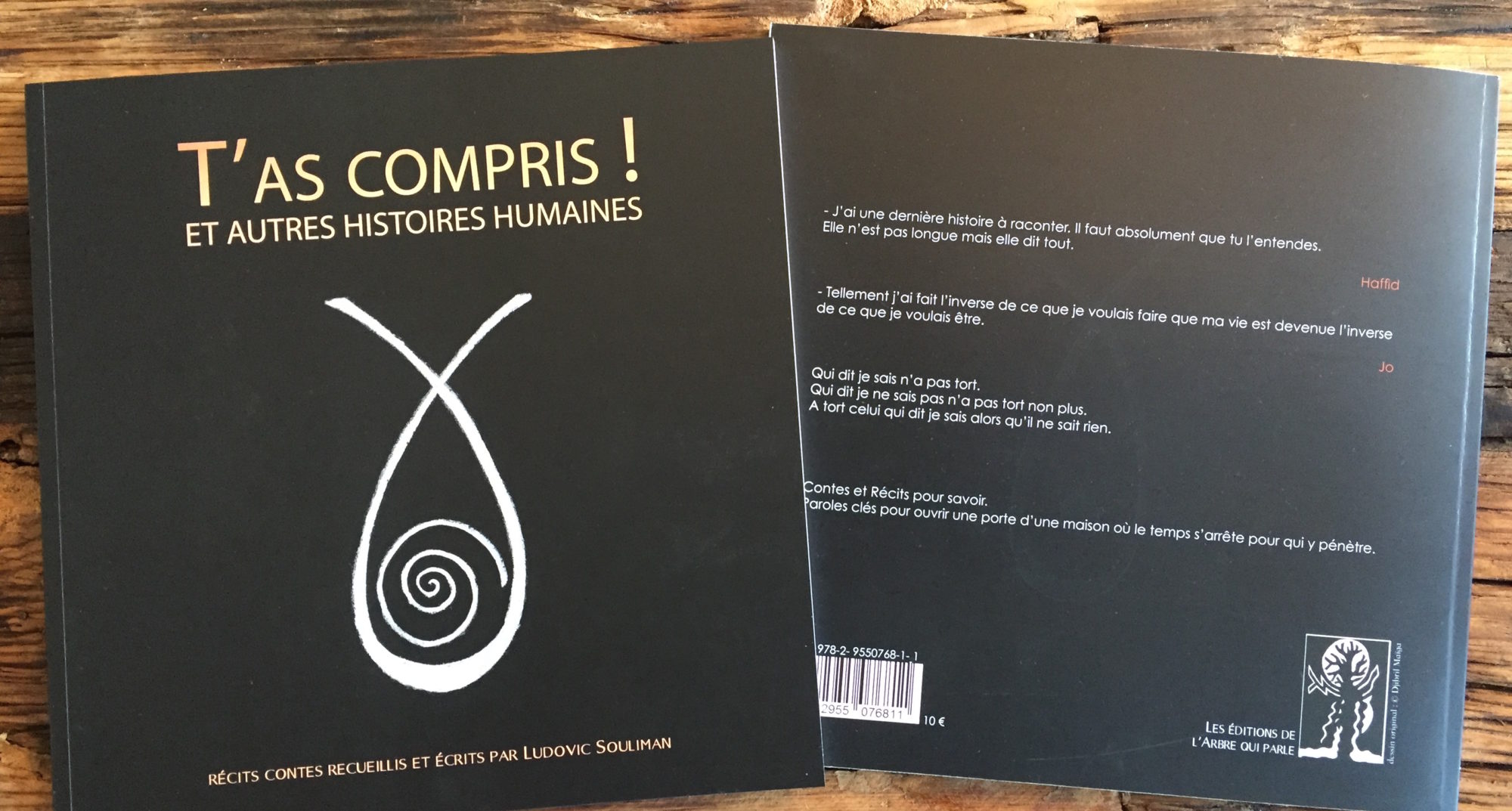Je pense que le progrès a apporté beaucoup de choses. Mais s’il a apporté beaucoup de bien, il aussi apporté beaucoup de mal. Il y a des choses dans le progrès qui sont biens et d’autres qui sont mal.
Avant, il y avait beaucoup plus d’amitié entre les gens maintenant, on ne se parle plus, à peine, bonjour et ça va ? Et encore.
A l’époque, il n’y avait pas le poste radio, il n’y avait pas la télé alors, on faisait la causette.
Maintenant, les jeunes, ils ont la musique sur la tête, ils ne savent pas chanter. Nous, dans le temps, on savait chanter. A notre époque, on chantait, c’était pas du tout prêt. Tandis que maintenant, c’est du tout prêt.
On chantait de tout. J’aimais chanter du Tino Rossi. Berthe Silva, ça c’était une chanteuse qui n’avait pas besoin de micro. Elle avait une voix. J’ai chanté tellement que je ne me rappelle plus combien je sais de chansons. J’aurais pu vous chanter des chansons toute la nuit sans chanter deux fois la même chanson.
Aujourd’hui, je n’ai plus de voix. Des fois, je m’en fredonne pour moi. Je me fredonne J’ai deux amours ou une autre, ça dépend de ce qui vient.
Les chansons, on ne les entendait pas à la radio mais sur les marchés ou sur les foires. Il y avait des vendeurs de chansons. Ils chantaient et ils vendaient les paroles sur une feuille pour celui qui voulait apprendre. Mais il fallait bien écouter l’air de la chanson pour bien l’encaisser. Il fallait encaisser l’air de la chanson dans la tête. Tout le monde chantait mais pour bien chanter, il fallait avoir la voix. Tout le monde n’a pas la voix pour bien chanter.
Aujourd’hui, on entend à la radio, avec les micros, n’importe qui peut chanter même qu’il n’ai pas de voix. Ce n’est pas la vraie voix, la voix naturelle. Ce n’est pas la machine qui fait le chanteur. A l’époque, pour chanter, il fallait avoir la voix. Quand tu dois chanter pour toute une salle sans micro, il faut avoir la voix. J’ai eu à chanter Tino Rossi pour une salle entière et sans micro. Là, il faut avoir la voix.
Jean Ferrat, c’était un vrai chanteur, c’était un poète. Il était pas loin d’ici à Entraigues. Il avait de belles chansons mais il n’était pas aimé par tout le monde car c’était un chanteur engagé. Il était proche des gens et c’est pour ça que tout le monde ne l’aimait pas. Mais même ceux qui n’avaient pas les mêmes idées que lui l’ont reconnu comme un grand à sa mort.
On chantait en famille. Quand il y avait un mariage, tout le monde devait chanter sa chanson, même celui qui ne savait pas chanter devait chanter sa chanson. Nous, on était une famille de chanteurs, ma sœur chantait et moi aussi, je chantais bien.
Ici, je peux plus chanter. Depuis que j’ai eu mon infarctus, je ne peux plus chanter car je n’ai plus de voix. L’infarctus m’a cassé la voix. Après ça, je n’ai plus chanter et ça me manque parce que j’aimais ça.
C’est la vieillesse. Tout le monde vient pas aussi vieux mais c’est pas marrant.
Fabien, 92 ans.