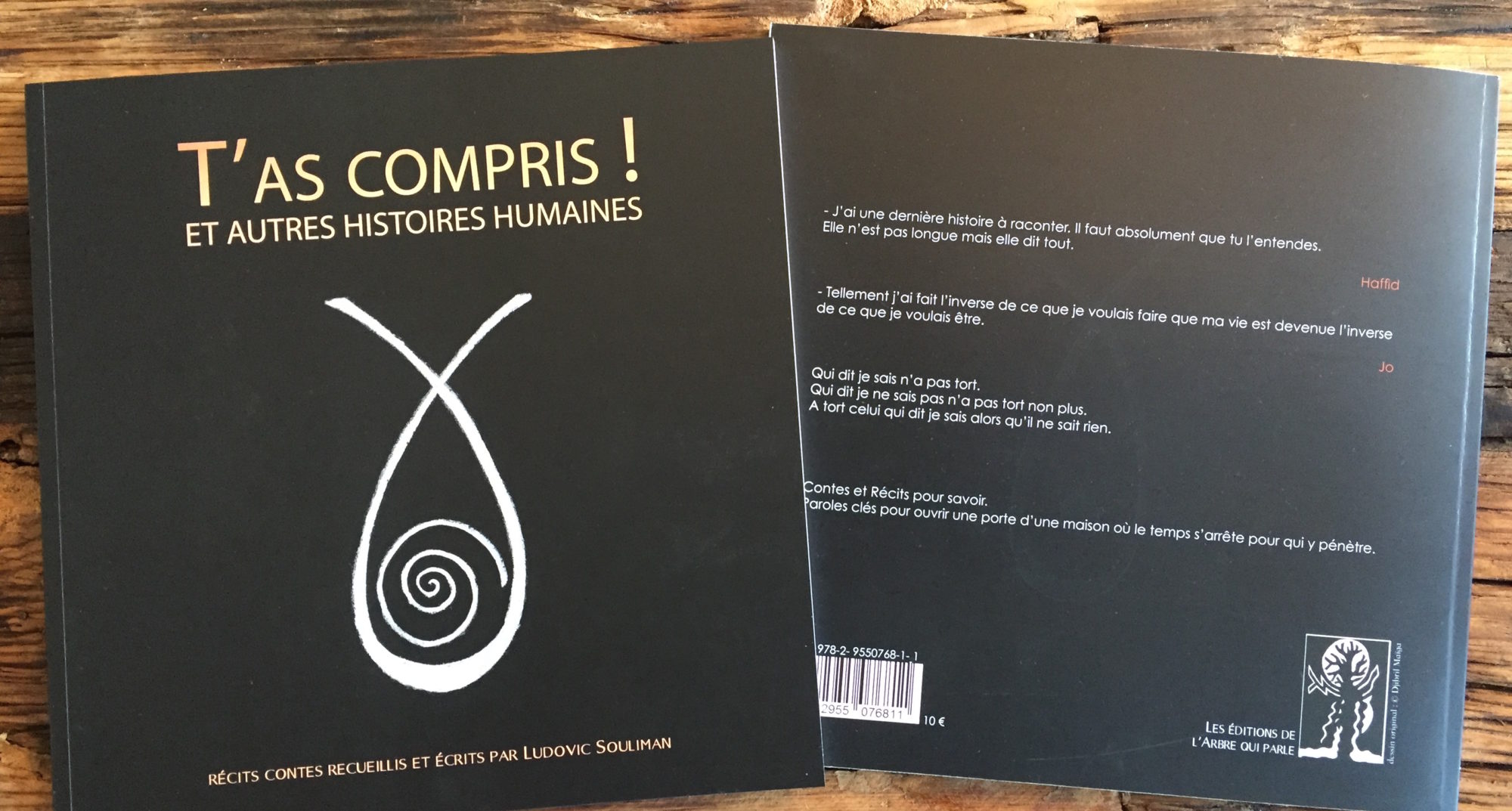Ça fait 27 ans que nous sommes ici à Ploubaz.
Ici, c’est la maison des grands-parents de ma femme. C’est des gens qui venaient de la région de Laon au Nord de Paris. Ils l’avaient achetée comme maison de vacances puis ils y ont passé leur retraite. Puis, dans les années 80, la maison a été transmise à ma femme et on est venu s’y installer.
Nous, on était autour de la quarantaine et c’était un virage dans notre vie, au niveau géographique mais pas au niveau de l’esprit.
Avant, pendant 15 ans on a vécu en communauté du côté de Nantes avec une vingtaine de personnes. J’avais 20 ans, ma femme Catherine 21, on est devenu prof tous les deux, mais au bout de 2, 3 ans on s’est dit : Non, on ne peut pas participer à un truc comme ça, l’éducation nationale telle qu’elle était.
Pour nous, le maître mot, à la fac de Nantes où on était en 68, c’était que ce qui tue les gens, c’est la société de consommation. C’est comme ça qu’on a décidé de vivre en communauté. J’y ai appris beaucoup de choses et surtout la tolérance. On n’avait pas de salaire, on avait des caisses communes qui servaient pour tout le monde et qui permettaient de vivre et d’acheter ce dont on avait besoin. On est parti de l’individu pour aller vers la communauté pour construire notre projet. Chacun avait sa cellule de vie individuelle ; on avait construit des maisons nous même pour chacun et on avait une part de budget pour nos besoins, pour nos repas du soir, pour nos enfants.
On faisait pousser des légumes, on avait un jardin, on élevait des bêtes. On était en partie autonome a niveau de l’alimentation. Je sais tuer un cochon. On faisait notre charcuterie.
Au bout de 15 ans, on est sorti de cette expérience de vie en communauté parce que ça ne correspondait plus à ce que l’on voulait vivre.
Même si c’est une utopie, un rêve, en 68, je me demandais :
– Pourquoi, le prof de fac est payé plus cher que la balayeuse ?
Et je me le demande toujours. Le jour où tout le monde gagnera la même chose, gagnera le même argent pour ce qu’il ait à même de faire, pour ce qu’il sait faire, il n’y aura plus de problèmes, il n’y aura plus de pouvoir des uns sur les autres par l’argent et chacun pourra faire ce qu’il aime.
On a fait le choix de changer de lieu tout en gardant notre ligne de vie, pour, à 40 ans, continuer ce qu’on imaginait, nous, travailler, faire des choses qu’on aime et qui dépendent de nous et acheter les patates qui nous permettent de nous nourrir.
On a quitté la région Nantaise et la communauté et on est venu s’installer ici.
Aujourd’hui, on continue à vivre selon notre choix de se mettre à l’écart de la société de consommation et la pub. En arrivant ici, ma femme avec d’autres a monté la Bio-coop de Paimpol. Elle a fait son chemin dans l’idée de consommer autrement avec la vente de produits bio et en offrant d’autres choix que la vente en grande distribution. Moi, je suis devenu céramiste.
Notre démarche a toujours été d’être en cohérence avec ce qu’on pensait.
On vit peut être de façon un peu marginale mais on vit selon notre choix en faisant ce qu’on aime. On n’est pas dans le rêve mais on est dans le concret, dans le faire.
Il y a une phrase de Victor Hugo qui me va bien et qui dit :
Il vaut mieux être dans le faire que dans le dire.
Jean Yves, 68 ans.