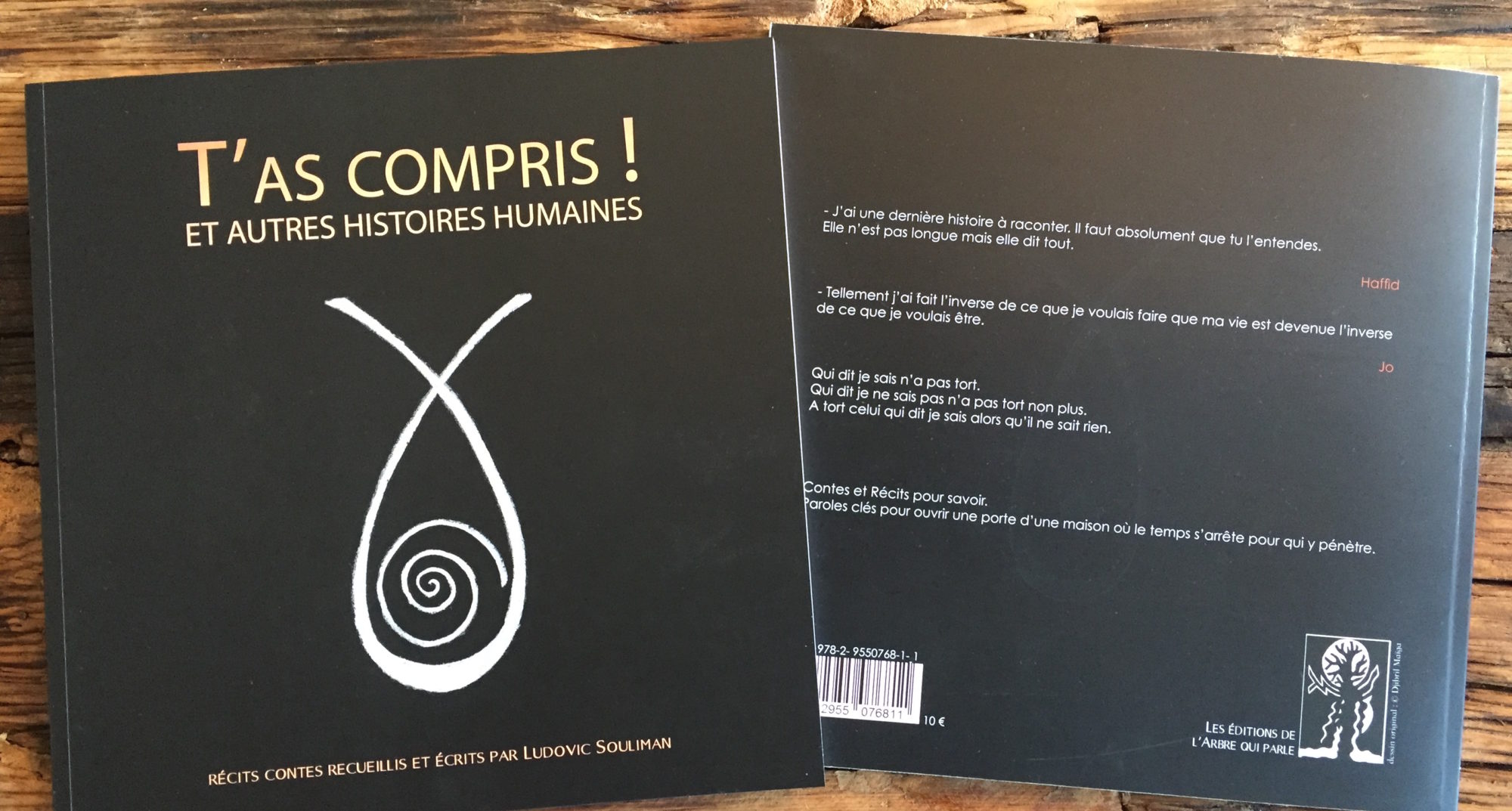Ça faisait huit jours que j’étais arrivé sur le centre et j’étais jeune plombier à Clermont-Ferrand. C’était l’hiver, il faisait froid, très froid, moins 17 à moins 20 degrés. J’avais jamais eu autant froid. J’en pleurais, tellement j’avais froid, à plus sentir tes mains, à plus sentir tes pieds, à avoir les oreilles gelées. On a eu un arrivage de casquettes fourrées. Tout le monde a eu une casquette sauf moi, qui était le dernier arrivé.
Je travaillais avec des anciens, il y en avait un, tout le monde l’appelait le Vieux, c’était un vieux gazier. Le matin, avant de partir, le Vieux, il me voit sans casquette.
– T’as pas de casquette jeune ?
– Non, ils ont du m’oublier.
Il va voir le contremaître.
– Pourquoi, le jeune, il a pas de casquette ?
L’autre le prend de haut :
– C’est comme ça ! Il a pas de casquette ! Il a pas besoin de casquette pour travailler. Les magasins sont fermés et on va pas en faire toute une histoire. Allez ! Au boulot !
– Ah bon ! Ça fait rien. A dit le Vieux.
Pour travailler, le matin, on chargeait les camions avec des grandes caisses en fer qu’on appelait notre baise en ville mais, dedans, c’était pas une brosse à dent mais tous nos outils propres et bien rangés. Je vois Le Vieux et les quatre autres mecs de l’équipe qui descendent leurs caisses du camion et qui les posent devant les bureaux. Puis, ils s’assoient dessus et ils fument leurs cigarettes tranquillement. Le contremaître sort de son bureau.
– Ben alors ! Qu’est-ce que vous faites là ?
– On attend.
– Vous attendez quoi ?
– On attend que le jeune il ait sa casquette.
L’autre, il s’est mis à gueuler comme un putois mais les gars n’ont pas bougé. Ils sont restés là, assis à attendre en fumant leurs clopes. Il n’y a pas eu un autre mot. A la fin, le contremaître a été au magasin et j’ai eu ma casquette. Et après seulement, on est parti.
Le Vieux s’appelait en vérité Nourrisson. Il est mort depuis. C’était une stature, un vrai géant qui parlait pas beaucoup mais quand il parlait, on l’écoutait.
Les anciens disaient toujours qu’il n’y a pas de petites revendications, que toutes les revendications sont importantes, de la casquette à la sécu.
C’est cette histoire qui m’a fait me syndiquer et plus tard qui m’a fait militer.
Ce geste de fraternité, de solidarité, a beaucoup marqué ma mémoire et je m’en souviendrai toujours.